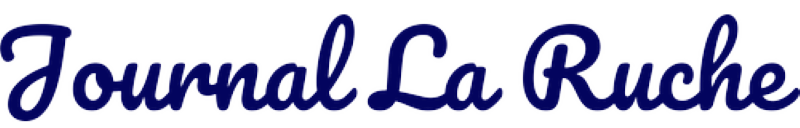Après plusieurs mois de conflit, un accord de cessez-le-feu a été signé entre Israël et le Hamas. Étant donné les différents enjeux et défis qui entourent cet accord, cette trêve, est-elle durable ? Un cessez-le-feu historique mais précaire : L’accord marque certainement un tournant dans le conflit, mais les défis restent nombreux. Cet article analyse les raisons de cet accord et les perspectives pour Gaza.
Dès le début de la guerre à Gaza, les dirigeants mondiaux ont commencé à œuvrer pour y mettre un terme. Pendant plus de 15 mois, Israël et le Hamas ont rejeté à plusieurs reprises les propositions de paix. Au cours de cette période, des dizaines de milliers de Palestiniens sont morts. Des familles israéliennes ont pleuré la perte de leurs proches retenus en otage à Gaza. Il y a une semaine, Israël et le Hamas ont finalement convenu d’une trêve. Dans le cadre d’un cessez-le-feu de six semaines qui est entré en vigueur le 19 janvier, Israël se retirera de certaines parties de Gaza et libérera des centaines de prisonniers palestiniens. Le Hamas libérera un tiers des otages qu’il détient encore. Les responsables espèrent que le cessez-le-feu cédera la place à une paix permanente, mais cela dépend de la manière dont les deux parties règleront plus tard des problèmes plus épineux. « Nous transmettons à la prochaine équipe une véritable opportunité pour un avenir meilleur au Moyen-Orient », a déclaré le président Biden, faisant référence à la nouvelle administration de Donald Trump. « J’espère qu’ils la saisiront. »
Entré en vigueur ce dimanche, le Hamas devrait libérer 33 otages par vagues sur six semaines. Il s’agira de femmes, d’enfants, d’hommes de plus de 50 ans et de personnes malades ou blessées. Une centaine d’otages sont toujours à Gaza, mais on estime que 35 d’entre eux sont morts. En échange, Israël devrait libérer environ 1 000 prisonniers palestiniens. Il devra également autoriser l’entrée d’une aide humanitaire supplémentaire à Gaza. Au bout d’une semaine, Israël retirera ses forces des zones les plus peuplées de l’enclave. Cependant, une préoccupation majeure demeure : certains détails sont vagues. Pour persuader les deux parties de signer, les médiateurs ont élaboré un accord dont la formulation est si vague que certains de ses éléments restent non résolus, ce qui signifie qu’il pourrait facilement s’effondrer.
Par ailleurs, on se demande quels seraient les facteurs expliquant cette tournure dans le cadre du conflit. Les négociations ont perduré pendant longtemps, pourquoi donc maintenant ? Il est vrai que le conflit a déjà connu de trêve : en 2023, peu de temps après le 7 octobre, une trêve avait déjà duré une semaine avant que la situation ne se dégénère. Pour celle-là, trois principaux facteurs peuvent être perçus comme les raisons ayant poussé les deux parties à conclure cet accord.
D’abord, le premier facteur concerne le succès d’Israël. Après près d’un an et demi de guerre, Israël a affaibli ses ennemis dans la région. Il a tué de nombreux combattants et dirigeants du Hamas, y compris le chef de longue date du groupe à Gaza. Il a détruit une grande partie du Hezbollah au Liban. L’Iran, qui soutient le Hamas et le Hezbollah, a également subi des pertes, notamment la chute d’un régime allié en Syrie. Grâce à ces victoires, une autre attaque comme celle du 7 octobre est moins probable, ce qui permet à Israël d’atteindre l’un des objectifs de la guerre. Le prochain facteur renvoie certainement aux efforts des présidents sortants et rentrant américain. Durant les dernières semaines, Biden et Trump ont fait pression sur Israël et le Hamas pour qu’ils parviennent à un accord avant la fin du mandat de Biden. Ce dernier a donc considéré l’armistice comme une partie importante de son héritage. Trump de son côté a toujours déclaré qu’il mettrait fin à cette guerre en une journée, ainsi il a voulu éviter d’avoir à traiter un sujet aussi difficile en tant que président. Les équipes des deux présidents ont d’ailleurs travaillé ensemble dans les négociations et l’accord final suit dans les grandes lignes le cadre proposé par Biden quelques mois plus tôt. Enfin, on pourrait considérer l’ensemble des pressions internes. En Israël, les critiques du Premier ministre Benjamin Netanyahu disent qu’il n’a pas fait assez pour libérer les otages. De nombreuses manifestations ont même eu lieu dans plusieurs villes du pays en rapport avec cet avis. À Gaza, les Palestiniens sont frustrés par le Hamas et réclament la paix alors que la crise humanitaire provoquée par la guerre s’aggrave de jour en jour. Ces pressions ont poussé les dirigeants israéliens et palestiniens à négocier.
En somme, l’accord étant entré en vigueur aujourd’hui, on a assisté au cours de la matinée la libération de quelques otages par le Hamas. Ce n’est pas fini, les deux parties devront donc tenir leurs promesses. Dans le cas contraire, le cessez-le-feu pourrait s’effondrer et les combats pourraient reprendre. Si cette trêve tient, les négociateurs prévoient de trouver un accord de paix plus durable dans les six prochaines semaines. Les termes d’un éventuel accord restent inconnus, même si le soutien d’Israël pourrait dépendre de la libération de tous les otages restants.